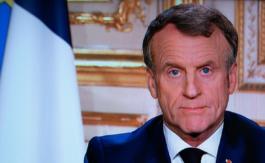Par Henri Bec
Président de la Restauration nationale Action française
Ancien magistrat
Le feu couvait depuis longtemps. Policiers et gendarmestravaillent dans des conditions matérielles déplorables, constamment sollicités dans des affrontements de plus en plus violents, en manque permanent d’effectifs, avec des rémunérations indécentes. Et pour finir, insultés par une minorité de révolutionnaires appuyés par une presse en grande majorité lovée dans le camp de « l’anti-France ». Seul le sens supérieur qu’ils ont de leur mission a permis un déclenchement tardif du mouvement. Mais tout a des limites, y compris la patience. Cela devait arriver.
À côté – et beaucoup voudraient qu’elle soit en face –, la justice fait également l’objet de critiques, lenteur et laxismenotamment, montées en épingle par l’autre côté de l’échiquier politique, les différentes composantes de l’opposition qui attendent avec impatience les prochaines échéances électorales. Inutile de revenir sur les conditions dans lesquelles travaillent l’institution judiciaire dans son ensemble, magistrats, greffiers, personnel pénitentiaire… Seul le devoir de réserve les a contenus dans une relative discrétion. Jusqu’à quand ?
Et c’est ainsi que les plateaux de télévision et autres réseaux sociaux résonnent de déclarations péremptoires, « la police tue » et « la justice ne s’intéresse qu’aux coupables ». Caricatural, un peu léger, et surtout signe d’une dramatique – ou volontaire ? – absence de réflexion politique.
Dans la crise qui secoue aujourd’hui police et justice, le gouvernement, toujours guidé par sa stratégie de conservationdu pouvoir a cru bon de prendre parti. Le ministre de l’Intérieur a estimé électoralement plus rentable de donner raison à la fronde policière et de critiquer une décision de justice sur des motifs éminemment polémiques ; sans se préoccuper le moins du monde du fossé qu’il creusait entre deux institutions dont le travail en commun est un des impératifs nécessaires à la protection de notre bien commun. Une attitude pour le moins déplorable. Il eut été plus opportun et surtout plus responsable de tenter des explications et des arbitrages. On n’a pas entendu, parallèlement, le ministre de la Justice défendre les décisions de ses juges !
S’il est deux domaines de compétence – parmi quelques autres – inhérents à la puissance publique, ce sont bien ceux de la justice et de la paix intérieure. Parce qu’il est difficile de trouver, en démocratie, un qualificatif qui définisse pleinement les institutions qui en ont la charge, les responsables de la République n’ont rien trouvé de mieux que de les qualifier, à juste titre, de régaliens, c’est-à-dire, étymologiquement,ressortant de la charge exclusive du roi. Police et justice ont en effet, depuis l’origine, tiré leur crédit et leur autorité du lien qui les unit au pouvoir politique.
Affectées au maintien de l’ordre, les forces de police et de gendarmerie constituent les bras armés du pouvoir exécutif. Leur mission n’est pas de prendre position sur le fond maisd’exécuter les instructions qui sont données. D’où le devoir imposé à l’État non seulement de préserver ces piliersessentiels de la sécurité et de la paix, en leur réservant toute l’attention requise, mais aussi de leur confier des missions qui ne soient pas au service d’intérêts particuliers, politiciens notamment. Ils ne sauraient être considérés comme les exécuteurs des basses œuvres idéologiques des partis au pouvoir. Les négliger depuis tant d’années est révélateur du mépris insultant manifesté par les gouvernements successifs. Il est peu probable que les rodomontades de circonstance de Darmanin suffisent à calmer les irritations. D’autant que les menaces de la hiérarchie de refuser des arrêts maladie – outre leur illégalité –, sont le meilleur moyen de mettre de l’huile sur le feu. Cette affaire rend, à l’évidence, le gouvernement anormalement fébrile !
Il en est de même de la justice dont le ministre, qui occupait jusqu’alors la deuxième place protocolaire dans le gouvernement, après le premier ministre, est désormais relégué à la cinquième place, donnant une idée de l’importance qu’Emmanuel Macron accorde à cette institution majeure, considérée de tous temps comme symbolisant la mission essentielle de l’État.
Une contradiction profonde doit cependant être relevée :
1- D’une part, parce qu’elle tire son autorité de celle de l’État,la justice est déconsidérée en raison même de ce lien. C’est de fait l’État qui assure le recrutement et la carrière des magistrats et exerce une autorité hiérarchique, sur le Parquet notamment. La déliquescence politique actuelle et les scandales qui se succèdent rejaillissent directement sur l’institution judiciaire et son personnel, en qui le peuple refuse de plus en plus sa confiance. Le pitoyable exemple de l’oligarchie au pouvoir a un impact direct sur son image. Les organisations syndicales de magistrats, toutes tendances confondues, ne cessent de réclamer une totale indépendance de la magistrature, surtout du Ministère public.
2- D’autre part, paradoxalement, personne – ou presque – neconteste la nécessaire unité d’action de ce même Ministère public sur l’ensemble du territoire et le droit de l’État de la mettre en œuvre, selon les priorités du moment ou des orientations qu’il estime devoir privilégier. Il doit pouvoir décider, coordonner et surveiller la politique pénale quis’impose. C’est ce à quoi s’emploie tous les ans la Chancellerie au travers de ses Instructions générales de politique pénale adressées à l’ensemble des parquets. Les magistrats du siège, et leur indépendance constitutionnellement reconnue, doivent aussi pouvoir compter sur sa protection. L’article 64 de la Constitution dispose que « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire », autorité judiciaire qui comprend aussi bien les magistrats du siège que du Parquet.
L’antinomie découle de la nature même de nos institutions démocratiques qui, par effet mécanique, génèrent un pouvoir partisan au travers des compétitions électorales et de l’actualité politique quotidienne. Peut-on à la fois exiger ou espérer recevoir du gouvernement des instructions guidées par le seul souci du bien commun, ou compter sur une protection sans faille, alors que ceux qui en ont la charge, Président notamment, restent, avant tout, préoccupés de leur (ré)élection et de la victoire de leur parti, obsédés par l’état de l’opinion, elle-même sensible à toutes les manipulations, malade d’uneinstabilité chronique ? D’autant que, cerise sur le gâteau, le ministre de la Justice est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour soupçon de conflits d’intérêts et sera ainsi jugé par ceux dont il assure la carrière. La démonstration devient caricaturale.
Comment protéger justice et police des interventionspartisanes de l’État, et « en même temps », maintenir le lienindispensable à un fonctionnement harmonieux afin depermettre l’exercice des fonctions régaliennes ? C’est le cœur de la difficulté. Le dilemme est-il insoluble ?
On voit tout de suite que son traitement ressort du niveau institutionnel c’estàdire politique. Quels sont les deux termes de l’alternative : Les magistrats et les forces de l’ordre d’un côté et l’État de l’autre.
– Tout d’abord la magistrature. Elle souffre d’un déficit, pour ne pas dire d’une absence totale de légitimité. En régime démocratique la légitimité repose sur le peuple souverain. Or le peuple n’intervient en rien sur l’institution judiciaire, nomination ou carrière. La formule des jugements, rendus « au nom du peuple français », est une pure fiction. Au surplus le principe de la séparation des pouvoirs interdit de donner aux autres pouvoirs, exécutif ou législatif, une quelconque prééminence sur le troisième, le pouvoir judiciaire. Il n’émane ni de l’un ni de l’autre.
Poussons le raisonnement et concluons que la seule et véritable légitimité des magistrats résiderait, en l’état de nos institutions, dans leur élection. L’expérience malheureuse, et de très courte durée, tentée à la Révolution a définitivement et unanimement convaincu tous les professionnels du droit, magistrats ou non, de renoncer à cette solution. Lesorganisations syndicales, y compris le Syndicat de la magistrature, toujours à l’avantgarde des réformes, n’envisagent nullement cette hypothèse. De très nombreux et solides arguments, tant juridiques que pratiques, qu’il serait trop long de reprendre ici, plaident aussi pour son abandon.
– Reste l’État. Afin que l’indépendance de la justice puisse se combiner avec sa nécessaire dépendance à l’égard du pouvoir politique, il n’y a plus qu’à rendre celui-ci véritablement indépendant. Nous avons vu que le Président de la République, lui aussi élu des urnes, ne saurait remplir ce rôle. La seule solution est de placer au sommet de l’État une instance politique, libre par nature, insensible à toute influence, seule en mesure de constituer la clef de voute indispensable au maintien de l’ensemble et ainsi éviter que lajustice ne devienne, soit un instrument au service des intérêts les plus dommageables au bien commun, soit une autorité en roue libre, livrée alors aux plus néfastes influences. On sait très bien ce que sont les moyens de pression.
Depuis son origine, l’autorité judiciaire – qui n’est pas un pouvoir judiciaire – est une autorité royale. Elle n’exerce sa fonction que par délégation d’un pouvoir qui lui est supérieur. « La justice, dira Portalis dans son discours préliminaire sur le projet de Code civil, est la première dette de la souveraineté ».
Une telle autorité aurait été en mesure de régler le grave conflit institutionnel actuel – qui va laisser des traces –, en redonnant à chacun la légitimité de son rôle et de sa fonction. Ayant comme unique souhait le retour de la tranquillité publique, reconnaissant du travail accompli par les forces de l’ordre, protégeant une justice équilibrée tout en restant le recours suprême, débarrassé de manœuvres ou de sous-entendus politiciens qui salissent leurs missions hautement salutaires, il eut été le seul et véritable souverain.